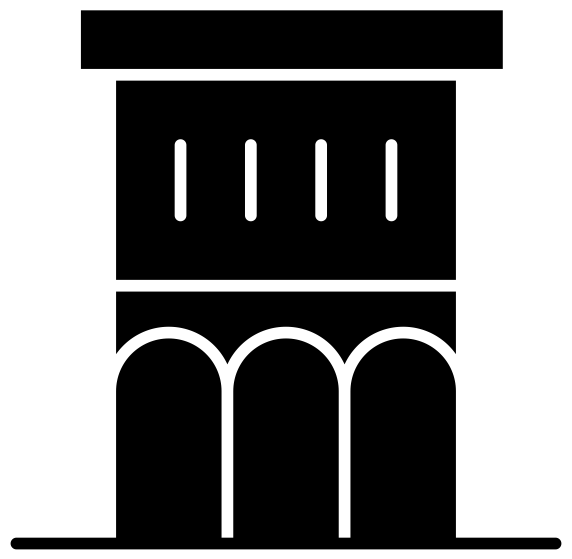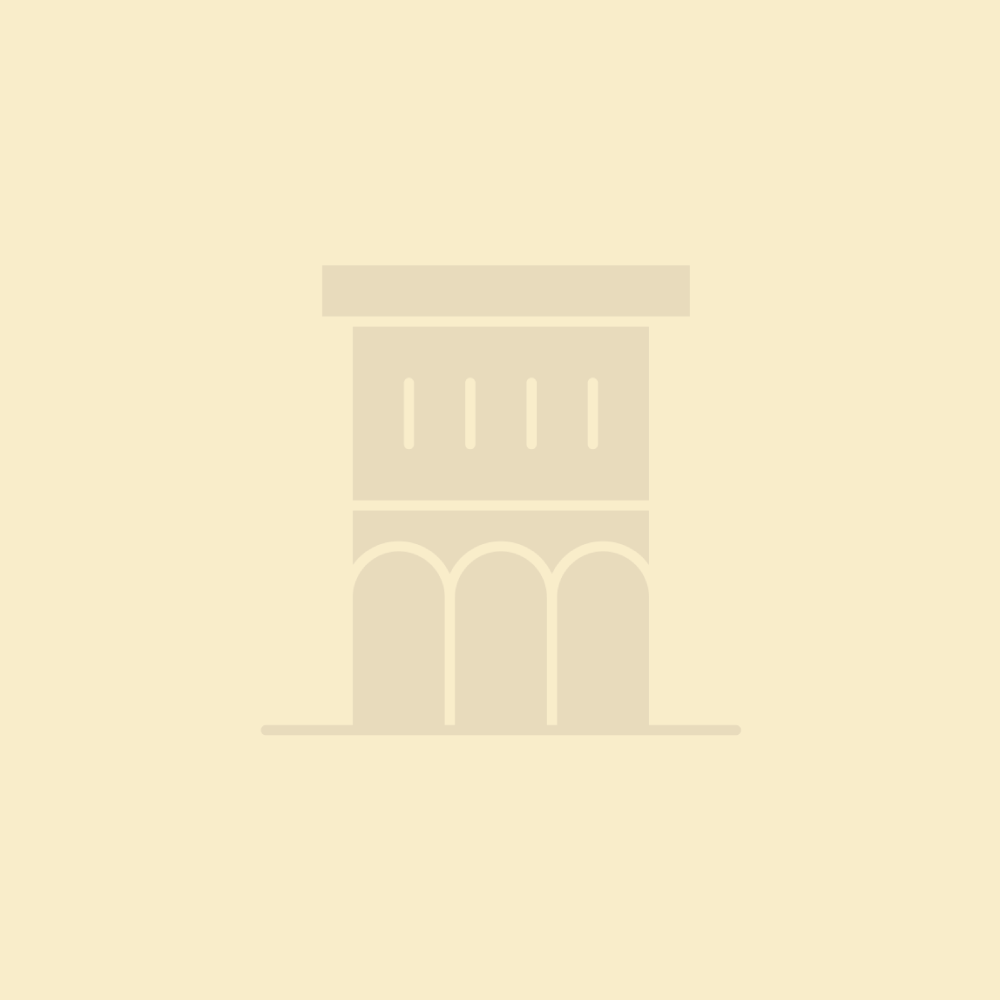
Eglise Notre-Dame-de-la-Croix
Architecture remarquable Voir sur la carte"L’église mesure 40 mètres de long, 26 mètres de large, 10 mètres de haut, et elle possède une surface de 520m². Son plan dérive du modèle basilical à vaisseau unique, présentant une forme en éventail qui s’ouvre à mesure qu’on va de l’entrée vers le choeur. Cela a pour effet de placer l’autel au centre de l’attention, au fond d’un espace ouvert et unifié. Réalisé en béton et en pierre de Chomérac, il est disposé légèrement en hauteur, entre le mur du fond concave et un emmarchement convexe, dans un espace qui évoque une mandorle. Par ailleurs, le sol est légèrement en pente, et la couverture légèrement haussée à ce niveau. Le parti structurel permet lui aussi l’ouverture de l’espace, disposant dans la nef cinq portiques en béton armé, invisibles depuis l’extérieur, qui supportent une double dalle de béton cellulaire de type Siporex en couverture, libérant les murs de leur fonction porteuse ; ceux-ci ne supportent que le poids des vitraux. Le plafond de l’église est légèrement voûté et laisse voir les marques du coffrage. Les murs sont quant à eux en moellons en pierre de Saint-Maximin à joints creux, pour l’église comme pour les annexes qui forment un ensemble. Le clocher s’élève à 17m et repose sur une dalle de béton formant auvent au-dessus de l’entrée de l’église, soutenue par deux piliers de béton qui encadrent la porte. La même dalle forme une tribune dans la nef au-dessus de l’entrée, soutenue par deux poteaux en béton dans lesquels sont intégrés des bénitiers moulés. Une sculpture avait été dessinée et prévue devant le clocher, figurant un saint portant la Croix, mais n’a pas été réalisée. Les huisseries et les vantaux sont en chêne, le dallage en comblanchien. Les entreprises ayant oeuvré à la construction sont Coutant pour la maçonnerie, Gibier pour l’électricité, Laubeuf, Barnabé et Vergnaud pour les menuiseries, Brideaud pour la plomberie, Raoul pour le chauffage, Le Bihan pour la serrurerie, Tomasina pour la peinture. Les vitraux sont l’élément le plus remarquable, occupant les deux tiers de le hauteur des murs. Ils constituent une grande baie continue qui parcourt toute l’église, sauf le choeur qui est aveugle : son austérité est valorisée par contraste, et reçoit l’éclairage et les couleurs transmis par les ouvertures. Cette composition rappelle les saintes chapelles médiévales bien que dans ces modèles le choeur soit ajouré. A Maisons-Laffitte, les panneaux en dalle de verre forment cinquante-six lancettes tenues par des meneaux en béton qui rythment et encadrent la composition. Le réseau de béton comporte des lignes horizontales en contrepoint. Dans ce quadrillage, le reste du réseau est librement composé au profit de formes abstraites et colorées. D’abord prévus avec des vergettes métalliques, les vitraux sont réalisés en dalle de verre selon le choix de l’architecte, sans doute pour des raisons économiques9 , et leur pose est terminée en mars 1962. Quatorze mille neuf cent petites dalles formant trois cent quatrevingt- douze panneaux sont ainsi conçues par André Ripeau, maître-verrier qui s’affiche comme étant catholique. Le développement de sa composition va du sud vers le nord : un éclatement de couleur évoque la révélation de Paul sur le Chemin de Damas, laissant ensuite place à la sérénité des épîtres du saint avec des fragments de textes choisis par le clergé (notamment le chanoine René Favre) ; suit une ambiance plus sombre autour de l’entrée afin de donner un aspect quelque peu tourmenté à l’entrée des fidèles venant de l’extérieur, puis viennent des tons plus joyeux et colorés. Ces forment doivent constituer un chant qui se poursuit en l’absence des fidèles10. Elles sont ponctuées de citations relatives à la liturgie de Notre-Dame des Sept douleurs tirées du livre de Judith et de l’Evangile selon saint Jean ; le texte est néanmoins parfois en partie caché par les portiques, comme si cette composition n’avait pas pris en compte leurs emplacements précis. André Ripeau souhaite une ambiance aux nuances fines, et évoque pour modèle les peintures d’Altamira ou les mosaïques de Ravenne, mais aussi les reliefs naturels des côtes bretonnes ou les failles granitiques de l’Orne. L’abandon de la figuration participe à concentrer l’attention sur l’autel, la célébration de la messe ou la prière, ce qui ici va dans le sens du parti pris architectural et du dénuement presque total de décor. Les ambons sont intégrés au bâti et son traités comme les murs. Le baptistère a été réalisé en 1964, dans une esthétique proche de celle du tabernacle et des chandeliers. Un autel secondaire a été disposé côté sud en 1967, surmonté d’une sculpture de la Vierge. Un Christ en Croix du XVIe siècle, inscrit au titre des monuments historiques en 1966, a été disposé au-dessus du maître-autel. Il est intéressant de noter que, bien que situé dans le fond, l’autel n’a pas eu besoin d’être déplacé pour célébrer la messe face au peuple, suivant les dispositions du concile de Vatican II. Un lambris a été posé en 2003 dans la partie basse des murs, sous les vitraux, pour améliorer l’acoustique. L’église ne dispose pas d’orgue, mais a pour projet d’en faire installer un. Une maquette de l’édifice est conservée dans la nef. Les annexes enfin, sacristie et presbytère, entourent le chevet et sont traitées de la même façon que l’église, créant une unité d’ensemble."
— Histoire"En 1957, le besoin d’un nouveau lieu de culte se fait sentir pour desservir le parc de Maisons-Laffitte, la chapelle située place Sully (dite des Jockeys) s’avérant trop petite. L’association diocésaine de Versailles obtient l’autorisation de construire une chapelle sur un terrain appartenant à l’association syndicale du Parc de Maisons-Laffitte, qui lui octroie une mise à disposition perpétuelle à partir du 22 octobre 1959. La première pierre est posée par monseigneur Alexandre Renard le 9 avril 1960, et la bénédiction a lieu deux an plus tard, le 1er avril 1962. La moitié du financement total est permis par la vente en 1961 d’un terrain de 10 151m² appartenant à la paroisse, situé rue du Tri, au profit de la commune, ce moyennant 300 000 francs. Le reste provient de dons et de prêts. La paroisse de Notre- Dame-de-la-Croix est érigée le 29 septembre 1963 et existe jusqu’au 1er janvier 1995, date où elle fusionne avec la paroisse Saint-Nicolas. Le programme d’une église de 700 places est confié à l’architecte Pierre Barniaud, comprenant des annexes pour la sacristie, le presbytère, une chaufferie et un local à mazout. Les vitraux sont conçus par André Ripeau, maître-verrier à Versailles, semble-t-il choisi par le biais du père Favre, et ils sont réalisés par les ateliers de Saint-Benoît-sur-Loire. C’est l’architecte qui a opté pour la dalle de verre et l’absence de figuration, en vue de créer une ambiance quelque peu mystérieuse. Une cloche datée de 1634 provient de l’ancienne église désaffectée, donnée par la municipalité. Une autre cloche est commandée en 1962 à la fonderie Paccard, baptisée Bernadette-Gérald."
— Adresse1 place Colbert
Maisons-Laffitte
Île-de-France
Localisation indisponible pour ce monument.