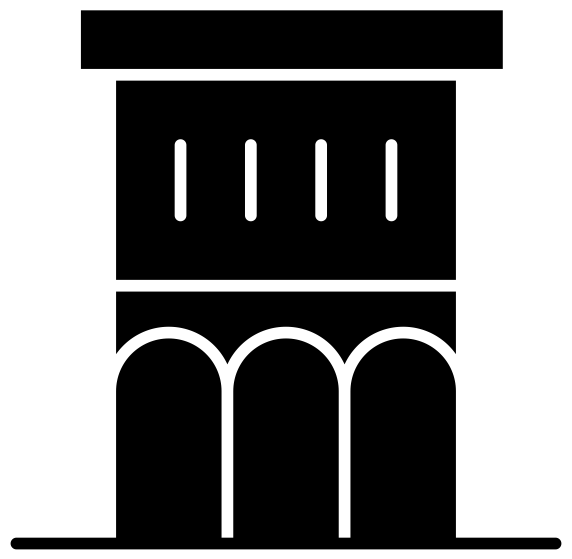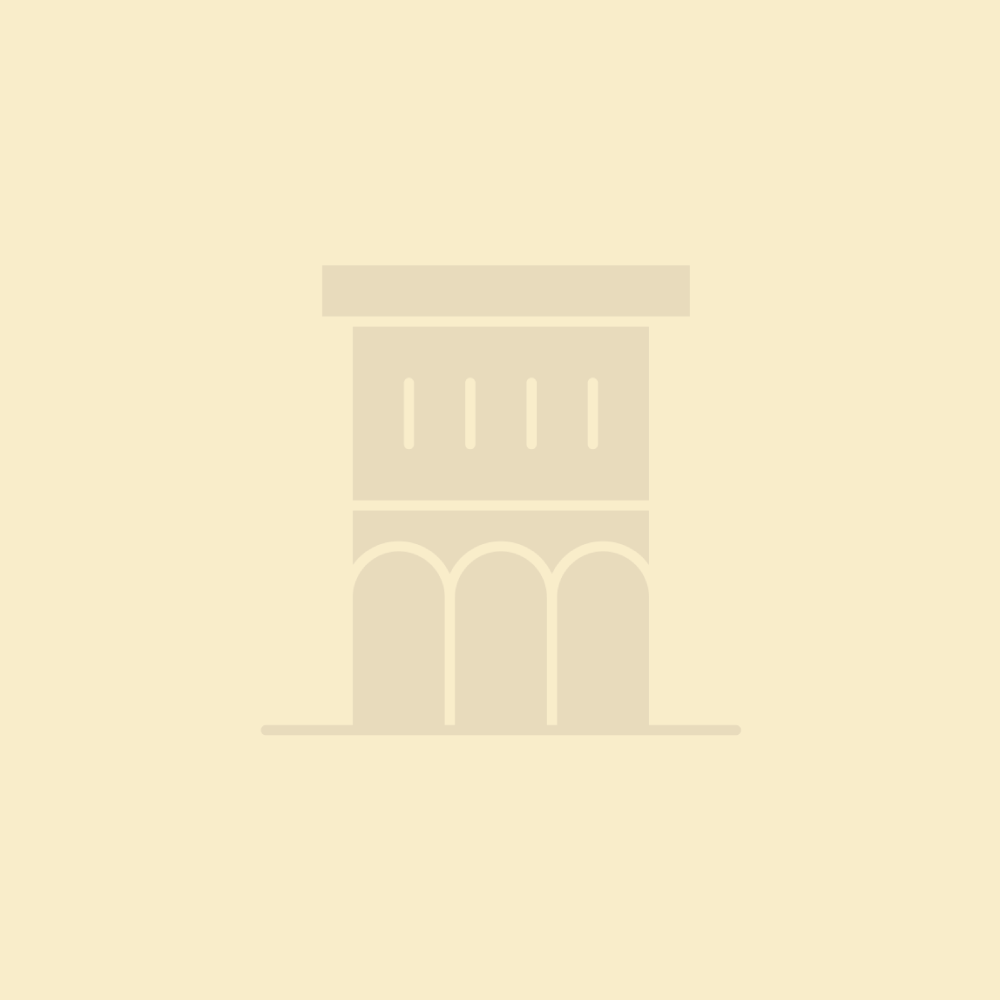
Eglise Saint-Thibaut-de-Marly
Architecture remarquable Voir sur la carte — Description de l'édifice"L’église haute est d’une surface de 700m² et peut accueillir 700 fidèles assis ; la crypte est plus petite de moitié. La plan est dérivé du modèle basilical, présentant un vaisseau unique dont les murs latéraux de la nef et du choeur sont obliques et convergent vers l’autel placé là où l’espace est plus resserré. Le sol est également en légère pente au direction de l’autel. Celui-ci est un peu avancé vers les fidèles, disposition de plus en plus courante après 1945 pour permettre au prêtre de célébrer l’office face au peuple, jusqu’à ce qu’elle soit officiellement entérinée par le concile de Vatican II. Afin de favoriser la participation des fidèles, l’instruction Inter OEcumenici de 1964, consécutive aux nouvelles dispositions liturgiques décidées dès 1963 par le concile, précise dans son point n°91 qu’« II est bien de construire l'autel majeur séparé du mur, pour qu'on puisse en faire facilement le tour et qu'on puisse y célébrer vers le peuple, et il sera placé dans l'édifice sacré, de façon à être véritablement le centre vers lequel l'attention de l'assemblée des fidèles se tourne spontanément », et redit dans son point n°95 qu’« Il est permis de célébrer la messe face au peuple14 ». Cette pratique est prise en compte dès 1946 par exemple par L’Art sacré lorsque la revue préconise des autels dont les deux faces sont travaillées pour prévoir ce cas de figure15 , et mise en oeuvre par exemple à l’église de Tromblaine en 1950. La célébration face au peuple est ainsi encadrée avant 1964, soumise à autorisation selon le Directoire pour la pastorale de la messe adopté en 1956 par les évêques de France. Nombreux sont les autels dont on peut faire le tour dans les églises construites après 1945, suivant un mouvement de fond plus ou moins marqué selon les endroits. Dans l’église du Pecq est ainsi appliqué un principe souvent sollicité avant d’être généralisé par l’Eglise, bien que ces novations aient aussi fait l’objet de débats16. L’ambon également remplace la chaire et est disposé à l’entrée du choeur pour les lectures et la prédication. Par ailleurs, le plan adopté permet de disposer deux autels secondaires disposées symétriquement au fond du choeur, dans les angles. La façade principale est très sobre, presque entièrement occupée par les verrières en dalle de verre de Maurice Rocher, peu lisibles de l’extérieur, excepté la nuit. Autour de l’entrée est disposée une grand cloison composée d’un châssis en bois et de nombreuses petites fenêtres rectangulaires. Les murs latéraux sont en béton armé préfabriqué et sont constitués de panneaux décalés les uns par rapport aux autres afin de laisser entrer la lumière de biais. De petites ouvertures triangulaires en partie basse permettent aussi d’éclairer la crypte. Le couvrement est fait de plusieurs voiles en bois lamellé-collé qui reposent sur une arête centrale courbe (de forme hyperbolique), elle-même formée de trois pannes en lamellé-collé assemblées par des tubes métalliques boulonnés, longues de 55m et montant jusqu’à 35m de hauteur. Cette arête est soutenue au niveau du mur pignon par un poteau en béton visible au niveau des tribunes, et dont la charge est reportée sur le plancher en béton de la tribune et transmise aux murs gouttereaux. Cette arête soutient les quatre voiles de bois qui se rejoignent au niveau de la flèche sans supports intermédiaires. Ces voiles sont composés de trois lits de planches de sapin de 13mm d’épaisseur, le premier lit étant embrevé sur la face intérieur, les deux autres à joints vifs ; ils sont fixés les uns aux autres par collage ou clouage. Ils ont été posés grâce à des chevrons provisoires, retirés par la suite. Cette charpente est initialement couverte par un revêtement synthétique à base de caoutchouc, puis par du cuivre à partir de 2002. La forme géométrique complexe choisie par les architectes et ingénieurs pour constituer la couverture est une paraboloïde hyperbolique, conçue pour avoir une capacité de résistance intrinsèque, reposant sur les murs en partie basse et sur l’arête centrale en partie haute, sans autre support. Cette forme, permise par l’usage du bois lamellé-collé, confère aussi à l’église un élan particulièrement fort, sensible à l’extérieur comme à l’intérieur, la flèche étant située juste audessus de l’autel. A cet endroit, le regard est comme happé vers le haut de la flèche, dont on ne perçoit l’extrémité qu’en étant situé au niveau de l’autel. Au départ, l’abside était projetée avec une grande verrière ; finalement, ce sont des failles lumineuses qui ont été aménagées à chaque rencontre entre les voiles du couvrement, marquant l’axe symboliquement central occupé par la flèche, et participant d’autant plus à donner l’impression d’une structure aérienne et délicate. L’arête centrale de la couverture est surmontée par des verres blancs. Des trois lignes lumineuses aménagées dans le choeur, seule la plus visible au centre est entièrement pourvue de vitraux, une composition abstraite dessinée par Maurice Rocher et réalisés selon la technique traditionnelle. Les deux autres comportent simplement quelques touches de couleurs au milieu des verres blancs. Les vitraux disposés en façade principale sont quant à eux en dalle de verre. Au-dessus de la tribune, de part et d’autre du poteau en béton se développe une composition sur le thème de la Résurrection où se dégagent des formes géométriques rouges (triangles, rectangles) et jaunes (cercle évoquant sans doute le soleil) d’où se dégage la Croix (également en rouge). Un orgue est installé dans l’église en 2008, placé derrière l’autel et composé de deux parties distinctes afin de laisser le vitrail central du choeur. Ses formes arquées doivent s’accorder avec celles de l’église, mais sa position centrale et sa taille imposante s’avèrent gênantes dans la perception des effets produits par l’architecture à l’endroit le plus sensible de la composition. Parmi les éléments de dinanderie, l’autel semble avoir été quelque peu modifié, même si son dessin actuel est très proche de celui d’origine (un agneau pascal sculpté en devant d’autel, oiseaux et poissons sur les autres côtés). Le baptistère comporte une simple croix et est placé sur un support à roulettes pour le rendre mobile. Le presbytère, construit en 1972, ne présente quant à lui pas d’intérêt particulier."
— HistoireEn complément de la construction des ensembles de logement des Grandes terres de Marly-le-Roi (Jean-Jacques Honegger, Marcel Lods, Luc et Xavier Arsène-Henry, 1952-1961, labellisés ACR) se fait sentir le besoin d’un lieu de culte pour les habitants des 1461 nouveaux logements et des communes alentours (Port-Marly, Mareil-Marly, Le Pecq où se construit le quartier des Vignes Benettes au début des années 1960, et le nouveau quartier du domaine de Montval à Marly-le-Roi quelques années plus tard). Une chapelle provisoire dédiée à saint Jean est installée en 1957 avant la commande d’une église par les futurs paroissiens rassemblés au sein de l’Association paroissiale des Amis de l’église des Grandes terres, constituée en 1959 en lien avec le père Félix Potier, qui devient association des Amis de Saint-Thibaut en 1962, le diocèse n’ayant pas les moyens de financer l’entreprise autrement que par un prêt. L’église est implantée sur la commune du Pecq, en bordure des Grandes terres. Le projet est choisi par une commission ad hoc, présidée par le président de la commission diocésaine d’art sacré. Les architectes Guy Perrouin, Claude Lunel et Pierre Jung sont choisis parmi une quinzaine de concurrents en 19611. La population est intégrée le plus largement possible à un projet qui se veut commun et non imposé (réunions, présentations du projets, sondage pour déterminer le niveau de participation financière acceptable pour la population). La bénédiction de la première pierre a lieu le 6 mai 1962 par Monseigneur Renard, et l’église est consacrée le 12 avril 1964. Courant 1965, la crypte est aménagée, et le chauffage est installé. Les architectes souhaitent ériger une église qui s’affirme par sa forme au-delà du décor et des signes, comme un signal entre les barres de logement dont elle se distingue. Malgré les contraintes financières, leur réflexion doit contribuer au renouvellement de l’art sacré en usant de nouvelles techniques et formes. Pour se faire, la conception d’une structure complexe en bois est dévolue aux ingénieurs Robert Lourdin et Raoul Vergez, qui travaillent avec les charpentiers de marine de Dieppe. Le projet bénéficie d’une aide du Centre technique du bois qui reconnaît son intérêt. Les cartons des vitraux sont dessinés par Maurice Rocher, transposés par les ateliers Degusseau, avec qui il collaborent à de nombreuses reprises. Les vitraux sont réalisés selon la technique traditionnelle dans le chœur, et en dalle de verre au-dessus de l’entrée, procédé plus économique choisi là où la surface est la plus importante. Concernant le mobilier, l’autel, le tabernacle et les fonts baptismaux sont l’œuvre de Jean-Paul Luthringer. Saint Thibaut, à qui est dédiée l’église, est un membre de la famille de Montmorency, né à Marly, ayant vécu au XIIIe siècle en tant que moine cistercien à l’abbaye des Vaux-de-Cernay, où il est inhumé en 1247. Il fût supérieur de l’abbaye de Port-Royal-des-Champs (fondé par sa grand-mère, Mathilde de Garlande), et canonisé dès 1270. On imagine en 1965 qu’une sculpture du saint pourrait animer la façade quelque peu austère, mais cela n’a pas été mis en œuvre.
— Adresse58 bis avenue du Président Kennedy
Le Pecq
Île-de-France
Localisation indisponible pour ce monument.