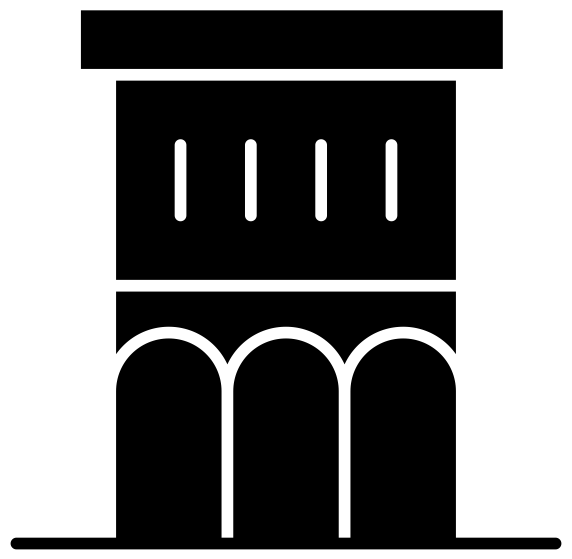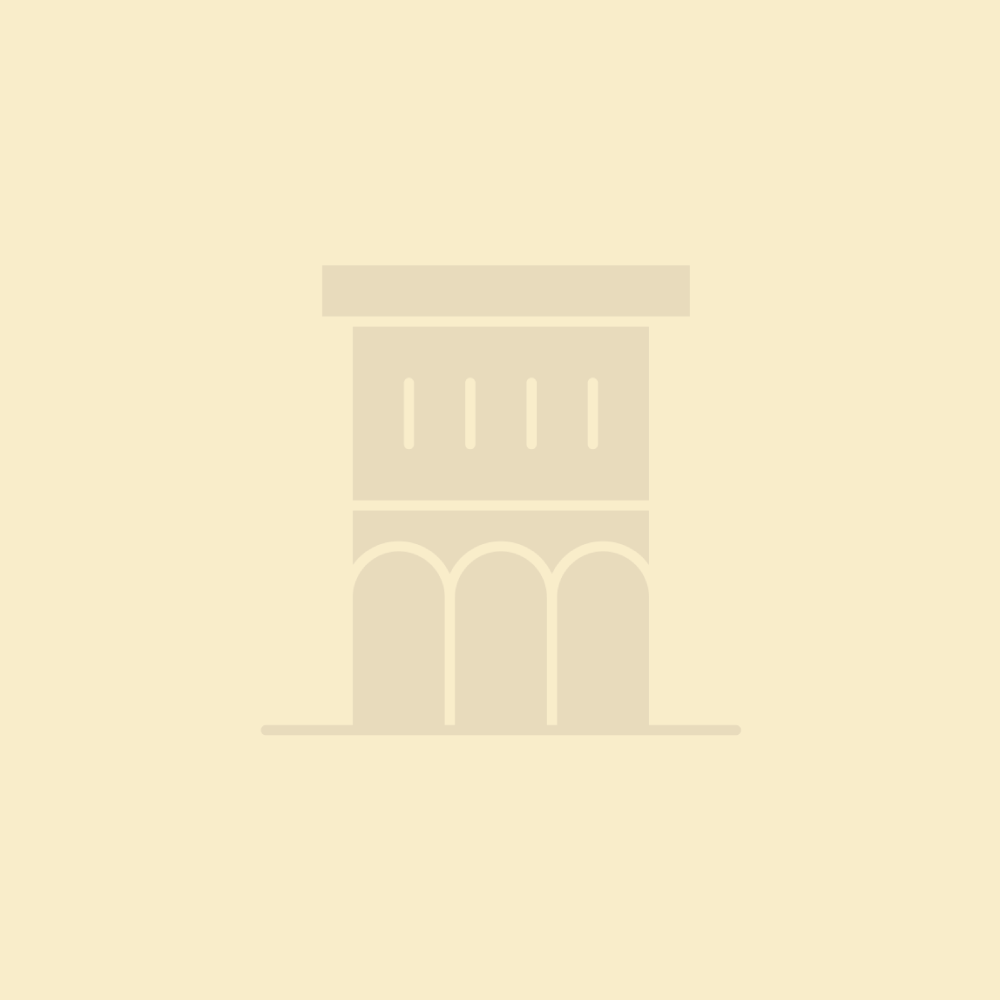
Villa Dagron
Architecture remarquable Voir sur la carte — Description de l'édifice"La villa présente un niveau d’habitation au-dessus d’un rez-de-chaussée inondable, soit 350m² habitables auxquels d’ajoutent 100m² de terrasse accessibles. Sa structure est constituée de cinq rangées de poteaux en béton armé disposés à intervalles variables, avec des murs de remplissage en béton cellulaire enduits. L’étanchéité des toits-terrasses est assurée par de l’isodrite (chape d’asphalte déroulée et dont les joints sont soudées à la lampe). Le plan, relativement simple, résulte de l’agencement de formes géométriques : un carré et un rectangle placé perpendiculairement, adjoints d’une chambre en demi-cercle d’un côté est d’une cuisine rectangulaire de l’autre. Les volumes s’imbriquent formant un édifice horizontal avec un étagement jusqu’à la terrasse sommitale qui surmonte la pièce principale servant de séjour. Les espaces intérieurs composent des volumes traditionnels, excepté la chambre semi-circulaire et le grand séjour à double hauteur formant salon et salle-à-manger. Ce séjour, muni d’une mezzanine, communique d’un côté avec la cuisine, de l’autre avec un couloir central desservant deux chambres côté sud ainsi qu’un dressing, et des pièces de service côté nord (salle-de-bains, toilettes, lingerie) ainsi que le vestibule d’entrée. Le couloir aboutit enfin côté ouest à la chambre en demi-cercle, éclairée par une fenêtre en bandeau. Aujourd’hui, la chambre communique directement avec la salle de bain et le dressing, ce qui n’est pas le cas dans le plan d’origine. Ce niveau est très ouvert sur son environnement, accessible au départ via trois escaliers extérieurs (un côté Seine au nord pour l’entrée principale, un côté sud-est reliant la cuisine et le jardin, un côté sud-ouest permettant d’accéder au jardin depuis deux chambres, ce-dernier n’existe plus aujourd’hui et son perron sert de terrasse) et éclairé par de grandes baies, particulièrement côté Seine dans le séjour (fenêtre comportant à l’origine une ouverture en guillotine), dont la position en surplomb ménage une vue jusqu’au village de Fontaine-le-Port. Dans L’Architecture d’aujourd’hui, il est précisé que la villa a d’abord été conçue sur pilotis, puis ce le projet a évolué au profit d’un rez-de-chaussée occupé par un garage pour automobile et bateau, une buanderie, une chaufferie, une cave, ainsi que deux chambres de domestiques5. Plusieurs poteaux sont laissés visibles à ce niveau, dont nous ne disposons pas de plan. Les murs sont aujourd’hui tous peints en blanc, et ne possèdent plus le revêtement de faïence présents au départ dans certaines pièces : rose pâle dans la salle-de-bains, jaune dans la cuisine et l’office. Des tablettes et consoles en béton étaient également couvertes de laque verte, et le mur est du séjour recevait une peinture de Jean Louis Moussempès, une carte fantaisie représentant la région. La cheminée, qui comprenait un petit bassin à eau courante au-dessus du foyer pour y déposer le produit de la pêche en attendant de les cuisiner, a été remplacée. Les sept petits pavés de verre circulaires qui la surmontaient sont toujours en place, bien que seuls cinq restent visibles de l’intérieur. Aucun vantail n’est d’origine, certains n’ont pas été remplacés pour créer des baies libres, et deux portes donnant sur l’extérieur ont été condamnées (dans le séjour et une chambre). Le couvrement de la porte reliant le séjour et le couloir a également été redécoupée. Les châssis de fenêtre ont tous été remplacés, mais certains ont été conservés après dépose, conservant des traces de peinture verte et blanche, de même que certains garde-corps. En revanche les garde-corps en métal Hélevard (à haute teneur en nickel les rendant inoxydables) des terrasses et des escaliers, y compris celui du séjour, ont été conservés, ainsi qu’un mat placé au-dessus du porche, dont on voit les points de fixation sur une photographie en 1932. Le séjour et la chambre ouest conservent également leur sol en grès cérame, de grande ampleur dans le séjour, aux motifs géométriques noirs, gris et blancs répétés évoquant un tapis ou un peau de reptile (Gilles Ragot les rapproche de réalisations d’Henry-Jacques Le Même à Mégève). La clôture extérieure a été refaite à l’identique, excepté le portillon, et le jardin comporte un puits au dessin très épuré dont la réalisation n’est pas datée ; il n’est pas visible sur les photographies publiées en 1932 et 1934 mais son esthétique s’accorde bien à celle de la villa."
— Histoire"Cette villa, publiée en 1932 dans L’Architecture d’aujourd’hui1, est celle d’un certain monsieur Dagron2, probablement un des membres de la famille d’industriels qui produisait de l’encre depuis plusieurs décennies. Erigée entre la Seine et la forêt de Fontainebleau à Samois-sur-Seine (parfois située à Fontaine-le-Port, commune limitrophe), en bordure du chemin de halage, elle est l’œuvre de deux frères peu connus, Paul et Albert-James Furiet. Paul Furiet étant décédé en 1930, malade depuis 1928 et ayant confié son agence à son frère en 1929, la villa a pu être projetée à la fin des années 1920 ou en 1930, et terminée au plus tard en 1932. Aucune archive primaire n’a pour l’instant été repérée sur cet édifice, qui a fait l’objet d’une seconde publication en 1934 dans L’Architecte3, très proche de la première. Parmi les acteurs cités, l’entreprise Storet et Chedel fournit les sols en grès cérame, et le peintre Jean Louis Moussempès réalise une peinture dans le séjour (disparue, ou conservée derrière des couches postérieures). Les photographies d’époque montrent également la présence d’un mobilier assorti à l’architecture, signé Charlotte Perriand, Le Corbusier et Pierre Jeanneret, qui n’est plus en place aujourd’hui (ou qui a pu y être placé pour les besoins de la photographie). Des luminaires Pertzel sont disposés en applique le long de l’escalier du séjour, mais nous ne savons pas depuis quelle date. La maison servait a priori de lieu de villégiature estivale, L’Architecte précisant qu’« il s’agit d’une villa destinée surtout à l’habitation d’été ». Près de l’eau, lieu de canotage, de pêche et de natation, elle affecte le style dit paquebot dans une veine moderniste, et comporte un garage à bateau. Servant aujourd’hui d’habitation principale, elle a fait l’objet d’une restauration en 2020 qui a permis d’éviter sa ruine, tout en occasionnant certaines modifications, dont le remplacement de tous les châssis de fenêtre et l’ajout de faux-plafonds notamment dans le séjour. La famille Dagron possédait également la maison adjacente côté ouest, selon le témoignage de son actuel propriétaire, et qui n’a pas été conçue dans le même esprit. "
— Adresse17 rue de la Queue-de- Fontaine
Samois-sur-Seine
Île-de-France
Localisation indisponible pour ce monument.